20 ans. Il aura fallu 20 longues années pour que le film de Verhoeven Showgirls se voie enfin réhabilité par la critique. Du moins, c’est le temps qui fut nécessaire à une certaine frange de la critique française afin de comprendre qu’elle avait devant les yeux un véritable chef d’œuvre. Comprenez par là la critique « officielle », « sérieuse » ou « fréquentable » – car il faut tout de même l’admettre, si le film a toujours compté de féroces détracteurs, il y a également toujours eu des voix dissonantes au sein de la critique, surtout en France. Mais voilà, les lois de l’« intellectuellement correct » sont telles qu’aujourd’hui, seul prime l’avis des sacro-saints Cahiers du Cinéma.
Alléluïa : grâce à un entretien avec Jacques Rivette que je ne sais quel archiviste a été repêcher (« Un des plus grands films américains » annonce fièrement le sticker sur le superbe Combo Blu-ray + DVD édité par Pathé), tout semble réparé : il n’est plus louche d’aimer Showgirls, qui passe du statut de « plaisir coupable » à celui d’« œuvre reconnue ». Vous pouvez donc maintenant officiellement aimer le film de Verhoeven : Jacques Rivette vous l’autorise, au nom de toute la Nouvelle Vague.
On espère juste que vous n’avez pas attendu aussi longtemps pour découvrir Showgirls. Si par malheur c’était le cas, rattrapez-vous vite avec Combo Blu-ray + DVD édité par Pathé…
Showgirls – Édition définitive
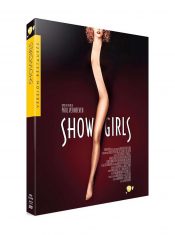 États-Unis : 1995
États-Unis : 1995
Titre original : –
Réalisateur : Paul Verhoeven
Scénario : Joe Eszterhas
Acteurs : Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon
Éditeur : Pathé
Durée : 2h08
Genre : Drame
Date de sortie cinéma : 10 janvier 1996
Date de sortie DVD/BR : 14 septembre 2016
Nomi Malone, surgie de nulle part, arrive à Las Vegas pour réaliser son rêve : devenir danseuse. Ses débuts fulgurants dans une boite de strip-tease lui ouvrent les portes des grands shows. Et la plongent également dans un monde cruel et sans pitié où ambition et jalousie sont les règles du jeu. Parviendra-t-elle à garder son âme ?
Le film
[5/5]
Cela n’aura échappé à personne : la raison pour laquelle Showgirls a toujours eu mauvaise presse auprès de la critique officielle et des femmes en général, c’est qu’il s’agit d’un film plein de « cul », que d’aucuns considèrent d’ailleurs parfois comme un vrai « film de cul » ou porno soft. Néanmoins, si la sexualité est occasionnellement le sujet central des films de Verhoeven, ce n’est pas le cas pour celui-ci ; il s’agit juste d’un élément formel fort, que l’on retrouve de toutes façons au sein de toute sa filmographie : il n’est pas un film dans sa filmographie où le spectateur ne découvre des seins nus, des putes, des bordels, des viols ou des personnages en train de faire l’amour : on pense à la sexualité débridée de Turkish delight, aux audacieuses masturbations féminines de Keetje Tippel, aux multiples viols de La chair et le sang… La sexualité ambiguë frôle souvent également la mort dans Basic instinct, Le quatrième homme et même Showgirls.
La sexualité a toujours tenu une place capitale dans la filmographie de Verhoeven, dés son premier film, Wat zien ik ?, une comédie narrant les tribulations de deux prostituées Hollandaises dans les années 70. Rythmé, souvent drôle mais ô combien anecdotique, ce film reste, à l’épreuve du temps, une comédie de situation bon enfant et sympathique que nous n’aborderons néanmoins pas en ces pages. Très représentatif de la culture Hollandaise dans le sens où l’on y parle de sexe comme on y parle de chaussures ou de bouffe -c’est à dire sans aucune gène et avec une liberté de parole surprenante- ce film avait été exploité en France comme un film érotique, dans le circuit de salles projetant des films érotiques, sous le titre Qu’est-ce que je vois ? qui est d’ailleurs la traduction littérale du titre original. Sur l’affiche n’apparaissaient ni le nom du réalisateur, ni ceux des acteurs. L’affiche de la comédie de Verhoeven fut même utilisée dans CinémAction pour illustrer le genre érotique dans un numéro spécial dédié aux « genres au cinéma ». Un peu paradoxal quand on sait que le film est une comédie ; encore plus paradoxal est le fait de ne voir nulle part dans la revue en question cité le nom de Paul Verhoeven ou un quelconque mot sur son film… La méprise n’est donc pas nouvelle : dans les années 70 comme dans les années 90, on avait tendance à prendre les films du Hollandais pour ce qu’ils n’étaient pas – de simples « films de cul » ; et si la représentation de l’acte sexuel est un élément récurrent du cinéma de Paul Verhoeven, celui-ci déclarait pourtant en 1993 :
« La plupart des scènes de sexe au cinéma ne servent à rien, parce qu’elles ne font que mettre en images la réalité, sans aucune surprise. Le couple est sur le lit ou ailleurs, il y a ces mouvements lascifs tournés au ralenti, cette lumière presque irréelle, mais il n’y a vraiment rien d’intéressant derrière tout cela, hormis prouver qu’ils font l’amour, comme tout le monde ! »1
La vision de l’érotisme par Verhoeven (et sa vision du corps en général), est très éloignée de la représentation classique du genre érotique, très « européenne » en un sens :
« Vous savez, j’ai baisé des filles pendant leurs règles. Certaines ne le veulent pas alors que d’autres n’ont aucun problème avec ça. Moi, je n’en ai pas non plus. Dans la société US, les règles sont inexistantes. Il ne faut pas en parler, et encore moins les montrer. »2
Avec ces mots d’une poésie et d’une délicatesse rare, Verhoeven commentait donc en 1995 sa vie sexuelle afin de défendre son dernier film à l’époque, Showgirls. Remake avoué de Keetje Tippel (un de ses films période Hollandaise), Showgirls est de son propre aveu, son « petit préféré ». Et finalement, si le réalisateur Hollandais n’est jamais avare de paroles, on l’avait rarement vu si disert qu’à la sortie du film en 1996. Attardons nous un instant sur son discours de l’époque. Si l’on compare la façon de s’exprimer du réalisateur pendant la promotion de ce film avec le langage qu’il utilisait avant (lors de la promotion de Robocop, Total Recall ou Basic Instinct), ou celui qu’il utilisera après (Starship Troopers, Hollow Man), on est surpris de l’engagement personnel dont il a fait preuve à l’époque lors de ses nombreuses interviews accordées à la presse. Mais ce qui détonne surtout par rapport aux diverses interviews que l’on put lire ou voir ailleurs, c’est le langage qu’il utilisait. A l’image du film, volontairement cru, aux limites de l’obscénité parfois, Verhoeven y allait de ses phrases « choc », quitte à passer pour un immonde phallocrate sans aucune pudeur. Bien sûr, les mieux informés parmi vous savent déjà que l’homme est quand même diplômé de maths et de sciences physiques, qui plus est marié depuis bientôt cinquante ans à la même femme : on pouvait donc être surpris de le voir ainsi employer une telle impudeur et une telle crudité. Il semble que le réalisateur ait tenu ce genre de discours pour, peut être, amener le public à réfléchir d’avantage sur le film, comme s’il admettait que celui-ci était peut-être, de premier abord, plus difficile à cerner. Comme s’il fallait lire entre les lignes de son discours, comme il faudrait lire son film. Force est de constater que beaucoup se sont arrêtés à l’image que véhicule Showgirls : phallocrate, vulgaire, obscène… Mais il convient d’analyser, de lire entre les lignes : Verhoeven est un cinéphile acharné, pour qui l’analyse précise d’un film est indispensable.
« J’ai donc disséqué pas mal de classiques. Je me replonge régulièrement dans Metropolis de Fritz Lang ou Ivan le terrible de Sergueï Eisenstein. Ces films sont une éternelle source de savoir. Il est clair que moi-même et toute mon équipe avons étudié Metropolis avant de tourner Robocop. Cela a également beaucoup influencé Total Recall, notamment en ce qui concerne la recherche architecturale. »3
Il est même curieux de constater que seulement quelques années plus tard, la violente charge à l’encontre des États-Unis au cœur même de Starship Troopers fut généralement beaucoup mieux perçue par le public et la critique. Comme si à cause de notre bonne vieille morale judéo-chrétienne, le fait d’intégrer une bonne dose d’érotisme au film immobilisait les capacités de réflexion et d’analyse du public…
Un film maudit
Showgirls est sans doute le film de Verhoeven qui fut le plus mal reçu par la critique dans le monde entier. Reconnaissons au moins au film cette qualité qui est de faire réagir violemment ses spectateurs, il ne laisse pas indifférent : soit-on adore, soit-on déteste. Il a été unanimement pourfendu par la critique internationale, à un tel point qu’il peut venir à l’esprit le concept de « film maudit », profondément incompris ; toutes les occasions étaient bonnes pour tenir des propos injurieux, parfois même à la limite de l’ordurier :
« La nudité fait vendre, Showgirls pue » 4
« Un triomphe du cynisme Hollywoodien » 5
« Les auteurs ont déclaré vouloir explorer de nouveaux niveaux d’impudeur à l’écran, mais le plus gros risque qu’ils aient pris est de tourner un film d’environ quarante millions de dollars sans personne qui sache jouer la comédie » 6
« Sans saveur : Showgirls amène la nullité à un nouveau niveau. » 7
En France, même les revues les plus consensuelles, telles que Studio Magazine ou Premiere le descendent en flammes :
« C’était sans compter sur la bêtise d’un scénario torché de lieux communs, de dialogues crétins de personnages minables, et de rebondissements à trois sous (…) C’était sans compter non-plus sur Elizabeth Berkley, à la plastique irréprochable mais dont le jeu hystérique et surchargé finit vite par horripiler. Car si la jeune fille danse bien, les chorégraphies qu’elle interprète feraient passer Flashdance pour du Nijinski. »8
Aussi, si le critique de cette revue caressait l’idée d’une réflexion sur la signification du film, il la rejetait aussi vite pour mieux continuer à ‘tirer sur l’ambulance’ ; s’il décelait bien un des éléments-clés du film, il renonçait à toute analyse pour rester à la surface :
« Et on se dit que tant de méchanceté et de bêtise ne pouvaient pas, de la part de Verhoeven, être un choix inconsidéré. Mais s’il déteste à ce point les Américains, peut-être ne devrait-il pas autant s’intéresser à eux, et encore moins pour une simple quête du scandale… »
Lors de la cérémonie des Golden Raspberry Awards ou Razzie Awards, qui se déroule parallèlement à la cérémonie des Oscars et décerne chaque année les prix aux plus mauvais films de l’année, Showgirls comptabilisait onze nominations sur les treize catégories en compétition : plus mauvais film, plus mauvais scénario, plus mauvais acteur et actrice, plus mauvais réalisateur, etc. Sur ces onze nominations, le film de Verhoeven récoltera sept récompenses, explosant tous les records précédemment établis. Verhoeven sera d’ailleurs le premier réalisateur de l’histoire à accepter les Razzie Awards et à venir les chercher sur scène. Avec un sourire sardonique, il tiendra ce discours devenu célèbre :
« Quand je tournais des films en Hollande, ils étaient qualifiés par les critiques de décadents, pervers et dégueulasses… [applaudissements fournis] Alors je suis venu aux États-Unis. C’était il y a dix ans. Et maintenant, mes films sont jugés décadents, pervers et dégueulasses dans ce pays ! [rires et applaudissements] Comme nul n’est prophète en son pays, ce déshonneur ne peut m’être infligé que dans mon propre pays ; dés lors il semble être devenu les États-Unis. Alors… je suis très content d’avoir obtenu tous ces Awards, parce que ça veut certainement dire que je suis accepté ici-bas et que je fais maintenant partie intégrante de cette superbe société américaine. Merci, merci beaucoup ! »9
Un discours qui nous rappelle finalement, par son cynisme proche du nihilisme le plus exacerbé, certains textes de Guy Debord :
« J’ai mérité la haine universelle de la société de mon temps, et j’aurais été fâché d’avoir d’autres mérites aux yeux d’une telle société. »10
Un travail sur l’image très ambitieux
Film-culte pour un certain nombre de cinéphiles (dont Jacques Rivette donc), Showgirls est un film profondément provocateur, très subversif, et surtout très efficace.
• Le scénario est certes épuré, dépouillé pourrait-on dire –à l’image des héroïnes du film– mais d’un impact émotionnel fort. D’ailleurs, les scenarii de Joe Eszterhas sont en général assez simples mais très puissants, très marquants parce que les milieux socioculturels dans lesquels se déroulent ses histoires font souvent partie intégrante du récit : rappelons-nous La main droite du diable (Costa Gavras, 1988), un film très fort, traumatisant même pour certaines âmes sensibles.
• Pour mieux servir ce scénario, Verhoeven opte pour une mise en scène luxueuse, clinquante, « empaillettée », efficace jusqu’à en être parfois écœurante. La mise en scène de Verhoeven est plus que jamais énergique, il montre ici qu’il sait indéniablement filmer à l’empoigne : la caméra est très mobile et place souvent le spectateur au cœur de l’action, quitte à le secouer ; beaucoup de scènes placent en effet le spectateur directement au cœur de l’action, Verhoeven utilise la caméra à l’épaule pour donner à certaines scènes une coloration plus brute, plus brutale même. On passe ainsi d’un élégant travelling dans les casinos de Las Vegas qui fait directement référence à Huit et demi de Fellini11 à des plans tournés caméra à l’épaule saisissants de puissance et de maîtrise.
• La direction d’acteurs colle parfaitement à cette esthétique : beaucoup de beaux gosses, bimbos et de « gueules » dans le film, tout est fait pour attirer l’œil – beaucoup de paillettes aussi, de jolies jeunes filles siliconées, de monuments dorés, d’enseignes clignotantes et de slogans criés haut et fort : la vulgarité est pleinement assumée par le cinéaste.
• Dans cette optique, le réalisateur fait également appel à une chorégraphe reconnue internationalement, Marguerite Derricks, pour mettre au point les shows musicaux : des shows très clinquants typiques des shows de Las Vegas. Il retrouve également son complice Jost Vacano à la photo, également hollandais et qui avait déjà travaillé avec Verhoeven sur Soldier of Orange, Spetters, Robocop ou encore Total Recall. Vacano aura surtout travaillé avec Verhoeven sur ses films ‘dynamiques’, son travail de chef-opérateur s’oppose directement au travail beaucoup plus élégant de Jan de Bont (Basic instinct…).
• Enfin, le réalisateur utilise le format Cinémascope, qui reste le gage d’un film soigné formellement : malgré son relatif attachement à la forme, c’était la première fois que le cinéaste hollandais utilisait le scope dans sa filmographie.
• Pour la musique originale du film, il s’offre la participation d’un auteur compositeur interprète très célèbre, Dave Stewart, ex-leader du groupe Eurythmics à qui l’on doit entre autres l’inoubliable Sweet dreams. De plus, de grands noms de la variété internationale composent pour le film des titres inédits (David Bowie, Prince, etc.).
Aux U.S.A, le film s’affiche clairement comme uniquement destiné à un public adulte : avec son budget de 39 millions de dollars, Showgirls est pourtant un blockbuster, un film à gros budget généralement exploité pendant la période estivale. Showgirls fut le premier blockbuster de l’histoire à être classé NC-17, c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. Cette interdiction fut créée en 1990 comme une alternative à la classification Rated X, qui ne s’applique guère qu’aux films porno. Néanmoins, financièrement, la classification NC-17 était un pari risqué de la part de la MGM, la major qui produisait le film, car il faut savoir qu’un film classé NC-17 n’est plus joué que dans 30% du parc des salles américaines.
Keetje Tippel, en 1974, était, de l’aveu même du réalisateur, un film raté, qu’il n’a pas eu la possibilité de finaliser comme il l’aurait désiré. En 1995, Verhoeven tient à ne pas réitérer les mêmes erreurs et pour obtenir du studio la possibilité d’avoir le montage final ou director’s cut, il s’engage par contrat à céder 70% de son salaire qui ne lui seront reversés qu’en cas de succès du film : c’est le prix à payer à Hollywood pour obtenir ce fameux final cut. Il comptait ouvrir la brèche pour des blockbusters destinés non pas à un public familial mais à un public adulte, car il désirait ensuite travailler sur son projet de biographie du marquis de Sade, un grand film érotique en costumes, qui aurait permis au réalisateur de réparer les erreurs commises sur Keetje Tippel. Showgirls ne récoltera malheureusement que 25 millions dans le monde entier et les espoirs de Verhoeven s’effondreront.

Des acteurs qui donnent tout
« Le pire dans tout cela est Nomi, qu’interprète Elizabeth Berkley, rude, sans grâce, et très vite fatigante : son personnage est si dur qu’elle n’en devient ni sexy ni même attirante. »12
On a beaucoup critiqué les acteurs du film, on ne comprend pas forcément pourquoi tant ceux-ci collent parfaitement à l’esthétique générale de Showgirls : une série de gueules incroyables, Kyle McLachlan égal à lui-même… Mais on reste surtout sidéré devant l’audace de la jeune Elizabeth Berkley, que Verhoeven comparait à la sortie du film à Marilyn Monroe13, et qui aura planté sa carrière avec cet unique film qui aurait dû la porter aux cimes du septième Art. Imperturbable, elle monta cela dit sur le bûcher de la critique internationale la tête haute et la fesse fière et orchestra à l’écran de façon mémorable la métamorphose physique et mentale de Nomi dans sa turbulente ascension vers les sommets : Verhoeven avait visiblement une foi inébranlable en son talent, et force est de constater qu’elle avait sans doute suivi préparation physique intense pour apprendre à danser, ou peut-être finalement « désapprendre ». De mémoire de cinéphile, on aura rarement vu une actrice se livrer avec une telle impudeur et une telle intensité devant une caméra.
C’est d’autant plus remarquable qu’elle ne vient pas de l’industrie du porno14, mais de la série télévisée pour ados Sauvés par le gong, extrêmement populaire dans les années 90. C’est là un virage à 180 degrés dans la carrière d’une très jeune actrice de 21 ans désireuse de changer d’image. En effet, l’actrice interprétait dans la série ‘l’intello de service’ ; dans Showgirls elle montrait à son public qu’elle avait aussi un corps. Malheureusement, ce changement radical ne lui aura pas porté chance, le film ayant été un bide retentissant dans le monde entier.
Showgirls comporte d’ailleurs une petite référence (volontaire ? Involontaire ?) à cette série dont l’univers était à peu près l’opposé total du film de Verhoeven le personnage masculin s’appelant Zack dans Showgirls comme dans Sauvés par le gong.

Un brûlot anti-américain
Dans le film, son personnage Nomi va réussir à percer et devenir la star du show Goddess (déesse). La scène où Nomi est engagée au Stardust est un moment grandiose et mémorable, où enfin un réalisateur hollywoodien montre le processus de réussite professionnelle, valeur capitale et inébranlable de l’American Way of Life, autrement que par le travail acharné.
« Peut être ai-je fait une erreur en pensant que le public américain voulait se voir lui-même. Ce n’est pas un film sur le sexe, mais un film sur comment s’en servir – comment se servir de son vagin. On se dit dés lors qu’il n’y a aucune différence entre utiliser son cerveau ou son vagin pour gagner de l’argent. Et je pense toujours qu’une des grandes idées du film est qu’il n’y a pas de raison pour dénigrer un quelconque talent, qu’il soit dans tes yeux, dans ta tête ou dans tes seins. »15
L’évolution de Nomi
Une des particularités du film est sa façon de montrer le personnage de Nomi évoluer au cours du film. Quand elle voit pour la première fois le spectacle Goddess, une série de champs / contre-champs nous la montre imitant les gestes et les pas des danseurs. La séquence se termine avec un plan magnifique où Nomi, au premier plan de dos, dévore de tous ses yeux la scène et les danseurs relégués à un arrière-plan rougeoyant de flammes (ou comment visualiser le désir et l’ambition de la jeune danseuse). Elle se projette totalement sur la scène idéalisée du casino, son paradis, qui deviendra également un enfer… Dans un deuxième temps, quand elle fera partie du show, Verhoeven nous la montrera grâce à des avancées dans l’axe de la scène en tant que témoin des différentes turpitudes qui s’y déroulent, mais également comme un des rouages de ce système arriviste où chaque danseuse est un requin prêt à toutes les bassesses pour prendre la place de sa partenaire. Enfin, lorsqu’elle aura conquis la place de meneuse de revue, Nomi restera cadrée en gros plan, enfin au sommet de la gloire, tempérée en amère victoire par le raccord sur sa copine Molly qui se détourne du spectacle affligeant de la victoire de la fin sur les moyens.
Verhoeven est un réalisateur cynique, et il est assez incompréhensible que sa férocité soit restée incomprise de la quasi-totalité de la critique. Celle-ci ne semble pas pouvoir supporter le spectacle d’un film profondément Sadien16 –Verhoeven connaît parfaitement l’œuvre de Sade et apprécie avant tout ses qualités d’écriture17 : il est donc Sadien et non sadique– qui pousse jusqu’à sa limite un principe qui au départ semblait banalement inoffensif.
Prenons un exemple : du début à la fin du film, tout le monde prend d’emblée Nomi pour une pute, et ne manque pas de le lui faire remarquer. A chaque fois, elle le nie avec véhémence : « I’m not a whore »18 est le leitmotiv des dialogues de Showgirls. Elle veut prouver son talent de danseuse, cacher son passé, lutter pour obtenir un peu de respect, ce que peu de gens lui accordent et lui accorderont. Elle sera prête à tout pour qu’on arrête de la voir comme juste une bimbo, une simple poupée ambulante. La simple répétition à l’écran de ces humiliations successives est proprement insoutenable, mais c’est aussi le meilleur effet cinématographique pour faire comprendre la vie de Nomi : le spectateur s’implique en effet beaucoup plus profondément dans le film, jusqu’ au malaise inévitable.
Pour Verhoeven, l’homme n’est pas un animal politique ; c’est un animal tout court : on peut parler souvent de pulsions plutôt que de décisions réfléchies : pensons à cette fille, dans Hollow man, qui sachant l’homme invisible sadique près d’elle, l’asperge avec les poches de sang qui étaient destinées à sauver son camarade et ami agonisant… Dans les années 70, Alain Resnais filmait dans Mon oncle d’Amérique des expériences sur le comportement animal et les comparait aux situations vécues par Gérard Depardieu et Nicole Garcia : on y voyait les réactions de souris blanches en cage confrontées à des situations typiques (douleur, plaisir, lutte pour la survie dans un environnement hostile…), tout ça monté en parallèle avec les séquences mettant en scène les acteurs. Verhoeven, lui, voit les Américains comme un troupeau d’animaux aux désirs exacerbés et violents, incapables d’apprendre et fonçant inlassablement dans le même mur…
Le premier plan du film, c’est Nomi qui fait du stop sur une highway du Midwest devant un panneau où est inscrit LAS VEGAS 528 MILES. Le dernier plan du film commence par le dépassement par la caméra d’un immense panneau « Nomi Malone : the new Goddess » et se termine sur la voiture de Nomi dépassant le panneau LOS ANGELES 641 MILES… Le discours est clair : Nomi n’a donc rien appris, et il est évident que le sort que lui réserve le rêve américain sera à Hollywood le même qu’à Vegas. Que ce soit dans une cage dorée ou dans un strip club, tout le monde la verra comme une pute ; ce destin tragique auquel Nomi ne peut échapper lui est été révélé par Cristal Connors, la star du Stardust (Gina Gershon) : « you’re like me, baby, you’re a whore… »19
C’est parce qu’il malmène ainsi le rêve américain que ce film de Verhoeven peut être si facilement considéré comme dérangeant et subversif ; par ailleurs, il pousse le bouchon jusqu’à dresser un parallèle entre Vegas et Hollywood, formellement évident puisqu’il ouvre et clôt le film – une des raisons, peut-être, de la mauvaise réputation de Verhoeven au sein même du système Hollywoodien.
Des rêves sans avenir
Dérangeante aussi est cette façon qu’a le réalisateur de construire son film en adoptant le point de vue de son héroïne écervelée, une fille paumée qui projette ses seuls espoirs dans un show plein de costumes légers et de poses suggestives… Soit carrément le sommet du mauvais goût ! Mais c’est avec une force de conviction renversante que Verhoeven affronte ce mauvais goût à la base même du projet : il fait preuve d’une grande tendresse pour ses personnages, à cent lieues d’un cinéma froid et désincarné d’un Stanley Kubrick par exemple.
C’est peut-être une autre explication de l’acharnement critique contre le film : on n’accepte pas d’être assimilé en tant que spectateur à une jeune fille qui est clairement présentée comme une ravissante provinciale un peu cruche. En effet, celle-ci n’a pas eu la formation à la culture nécessaire pour savoir comment prononcer le nom du créateur de mode Gianni Versace. Peut-être que le spectateur n’aime pas être assimilé à ce genre de personnage, et se range dés lors aux côtés des autres personnages du film : elle ne sait pas prononcer « Versace », on la considère donc comme une plouc, et le cinéaste se voit taxé de cynisme, à la façon des frères Coen sur Burn after reading dont on aura beaucoup dit qu’ils prennent un peu leurs personnages de haut.
De plus, les rêves de cette jeune femme sont sans avenir, le public et la critique sont peut-être tombés dans le même piège que l’intégralité des personnages du film : ils ne voient qu’une « pute » en Nomi, prête à tout pour s’accaparer le haut de l’affiche du Goddess, aboutissement merveilleux et rococo de sa courte carrière. Dés lors, le public fuit devant ce conte de fée sans avenir à base de plume dans le cul, on préfèrera le côté politiquement correct d’un film tel que Pretty Woman de Garry Marshall qui narre l’aventure bien plus romantique d’une pute qui finira par se marier avec un milliardaire : on oublie souvent que le ‘prince charmant’ en question était d’abord un client…
Dans le même état d’esprit, les seuls personnages qui témoignent un peu d’amitié à Nomi sont deux blacks : sa roommate Molly, couturière au Stardust, et James, lui aussi sincèrement passionné par la danse. Les deux personnages deviendront les uniques rayons de soleil dans la dure vie de Nomi. De par la couleur de leur peau, eux aussi ont vécu la dureté et l’âpreté du rêve américain : « life sucks, you know… »20. L’obligation de se créer un nouvel idéal fonde la part d’humanité de leurs sentiments et de leur comportement, à l’opposé des autres personnages du film, obnubilés par le roi Dollar. L’une ne jure que par son idole, un chanteur country qui finira par la violer, l’autre veut être reconnu dans le milieu de la danse mais ne peut proposer de créations à Las Vegas à cause de sa couleur de peau : dans les deux cas, la désillusion est sévère et leur tombe dessus alors qu’ils étaient prêts à y croire.
La dernière séquence du film
La dernière séquence du film (environ 20 minutes) constitue à elle-seule un morceau d’anthologie.
Ayant accepté de coucher avec le directeur artistique du Stardust (McLachlan) pour être la doublure de Cristal Connors, ayant poussé cette dernière dans les escaliers afin de prendre sa place, Nomi devient la star du show. Une gigantesque réception, une party à l’américaine, est donnée en son honneur. Un montage parallèle nous montre Nomi capitalisant ses mauvaises actions en dansant avec Zack sur une musique langoureuse, tandis que sa copine Molly se fait violer dans une chambre au-dessus par une star de la country. En alternant de plus en plus rapidement les plans de la fête et les plans du viol, le montage de Verhoeven nous montre quelque chose : c’est que même si elle s’en défendait tout au long du film, Nomi est maintenant bel et bien devenue une « pute » : elle a couché avec Zack et poussé sa rivale pour la renommée et pour l’argent.
Aussi, elle est devenue le jouet de cette industrie du divertissement à paillettes qui a provoqué le viol de sa copine, de celle qui l’a toujours acceptée sans la juger. Cette scène est aussi le parfait exemple de l’efficacité de Showgirls : ce passage est tout bonnement insupportable, écœurant, à tel point que le spectateur est tenté de détourner le regard… Même 20 ans après la sortie du film, cette scène reste toujours aussi profondément dérangeante car Verhoeven n’utilise pour la montrer aucun procédé de distanciation comme d’autres réalisateurs seraient tentés de le faire21 : Verhoeven montre vraiment cet acte dans toute sa réalité et son horreur.
Toutefois, comme par miracle, le sentiment d’une humanité perdue électrifie un moment les pensées de Nomi. Son passé de « 15 bucks hooker »22 venant d’être révélé par Zack, elle n’a plus rien à perdre et, pour une fois, l’instinct (basique) de domination sur son groupe laisse la place à des sentiments : la compassion et la tendresse. Et c’est bien ça qui fait tout le prix de Showgirls dans la filmographie de Verhoeven : c’est le seul moment où un des personnages quitte sa carapace animale pour, enfin, éprouver des réactions humaines. C’est le désir de vengeance qui l’animera par la suite : elle voudra à tout prix casser la gueule du violeur de sa meilleure copine, et ce quoi qu’il puisse en coûter à sa carrière de danseuse, pourtant conquise au prix de sacrifices et d’efforts. La séquence où Nomi défonce littéralement la tronche du bellâtre maléfique est un chef d’œuvre de rapidité et d’efficacité, qui ferait pâlir de jalousie un Tsui Hark. C’est aussi un chef d’œuvre d’ambiguïté sur la mise en scène nécessaire à la victoire : c’est la seule scène où Nomi accepte d’endosser ce rôle de « pute », afin de détourner l’attention des gardes du corps et de la star. Puis elle retourne à l’hôpital dire adieu à sa copine Molly, qu’elle a indirectement envoyée à l’hôpital. En sortant de sa chambre, Verhoeven nous donne un plan magnifique où Nomi hésite devant les ascenseurs, puis se décide et entre finalement dans la chambre de son ex-rivale, Cristal Connors, qu’elle a aussi envoyé à l’hôpital, mais de façon nettement plus directe.
S’en suit entre ces deux femmes un des plus beaux baisers de l’histoire du cinéma : un baiser qui pour le spectateur Fbrûlotfera office de rédemption, concédé par un personnage qui vient de tout perdre, et devrait tirer des conclusions de sa chute, mais qui s’enfermera finalement -c’est ce que nous montre le plan final du film- à reproduire ad vitam le même schéma.
Le réalisme / l’érotisme
Cela n’aura échappé à personne, dans Showgirls, Verhoeven montre tout de ses personnages qui se livrent d’une manière incroyablement crue. La moiteur transparaît dans chaque plan, surtout dans les plans de Nomi au Cheetah’, boite beaucoup plus miteuse que le Stardust : l’actrice est constamment luisante de transpiration, ce qui laisse au spectateur le goût d’un film un peu craspec, moite, sentant presque le popper’s à travers l’écran. C’est pourtant ce qu’on pourrait appeler la méthode Verhoeven, qui consiste à insuffler à chaque film cette idée de réel, de transpiration, de sueur, propre au corps de chaque être humain : le culte du propre, la chasse aux transpirations et aux odeurs de toutes sortes nous sont tellement martelés par la publicité à la télévision et dans la presse que notre culture assimile vite cela à la saleté.
Verhoeven montre pourtant des choses tout à fait naturelles mais qui restent des choses à cacher, des sujets tabous dans nombre de pays : transpiration, hygiène intime, divers problèmes gastriques…Des sujets qui sont beaucoup moins considérés comme tabous dans les pays européens du Nord, généralement plus libéraux. Pour citer un exemple, Verhoeven utilise comme ressort dramatique les règles féminines, qui reviennent à de nombreuses reprises : par soucis de réalisme (le réalisme est selon lui l’aspect le plus important de la culture hollandaise23) et par provocation envers le système américain qui voudrait n’y faire jamais allusion, le cinéaste se régale à montrer ses personnages féminins non seulement en parler mais aussi les montrer à l’écran… Ainsi, comme on peut le lire dans le petit livre de Paul Verhoeven, de Jean-Marc Bouineau24 :
« Aussi, je crois que les artistes hollandais ont toujours tenté de rendre les choses de manière aussi proche que possible de la réalité, même si pour cela ils sont obligés de montrer ce qui ne l’était pas auparavant…Un peu comme cette scène dans Turkish Delight, où l’héroïne prend peur parce que ses selles sont rouges ; elle va aux toilettes, les ramasse pour y jeter un œil, puis les remet à leur place, parce qu’elle se rend compte qu’il ne s’agit pas de sang mais des betteraves qu’elle avait mangées la veille ! Je ne pense pas que vous verrez de telles séquences dans un film italien ou français et certainement pas dans un film américain. Ce sens du réalisme fait partie intégrante de notre mentalité nationale »
Dés lors tout peut sembler vulgaire, grossier, incongru, car Verhoeven ne montre pas au spectateur des choses que celui-ci a l’habitude de voir : des personnages que l’on peut sans conteste qualifier d’‘anti-héros’ : Nomi, le personnage principal, est une jeune provinciale paumée et plutôt idiote ; quant au reste du casting, ce n’est qu’un défilé de personnages antipathiques, profondément vénaux et vicieux –dans tous les sens du terme. Par souci de réalisme encore, Verhoeven appuie sur le vide existentiel et le côté ‘normal’, banal qui habitent ses personnages et Las Vegas. A l’image de la ville, ces personnages s’expriment à travers leur paraître et leur sexualité, sexualité que Verhoeven filme sans tabous, d’une façon extraordinairement crue et… ‘humide’. La scène durant laquelle Cristal Connors « offre » Nomi à Zack en danse privée, celle durant laquelle Nomi interrompt brutalement ses ébats sensuels avec James parce qu’elle a ses règles ou la mémorable « séquence de la piscine » sont des moments où la sensualité, l’érotisme et la transpiration sont presque physiquement palpables par le spectateur. Des scènes d’un réalisme incroyable et clairement inhabituel dans le cinéma américain.
Par associations d’idées, on pense par exemple très vite au film Striptease (Andrew Fleming, 1995), qui se posait à sa sortie en concurrent direct au film de Verhoeven. Ce film avec Demi Moore était l’archétype du polar érotique américain, pathétique : scénaristiquement nul, caricatural, mal joué, mal éclairé, mal réalisé. Le réalisme de l’entreprise était déjà limité à la base du projet : la star n’ayant accepté de dévoiler que le haut, on assistait médusé aux déhanchements d’une strip-teaseuse de bientôt quarante ans qui ne dévoilait que sa poitrine… Les scènes érotiques du film étaient banales, aseptisées, ce qui n’est naturellement pas une fin en soi, mais qui, dans ce genre de film, pouvait passer pour une arnaque pure et simple. Au niveau des éclairages, la grande force du film de Verhoeven était d’aller à l’encontre de la démarche généralement utilisée aux USA : Striptease quant à lui est un film pérave, photographié sur le modèle de Neuf semaines et demi, avec des éclairages froids voulus élégants mais un peu déshumanisants, et privilégiant les plans éloignés, ce qui, bien sûr, exclut l’idée de s’attarder sur le grain de peau des acteurs ou sur une quelconque transpiration.
Showgirls est donc –quant à lui– un film très chaud, très moite ; Verhoeven se rapproche davantage ici d’un cinéaste tel que Tinto Brass, érotomane italien qui déclarait en 1988 « Toutes les humeurs m’intéressent. Les humidités. La sexualité sans humidité est quelque-chose…d’Hollywoodien »25
Cette déclaration colle parfaitement au film tant Verhoeven appuie –une nouvelle fois dans sa carrière sur cet aspect.
Verhoeven et le cinéma érotique
Ce parallèle avec le cinéma érotique et Tinto Brass n’est pas un élément fortuit ; cette coloration réaliste sert également le film car elle lui donne aussi un coté assez excitant pour le spectateur masculin (en général). On n’a souvent vu dans le film que son concept racoleur : les shows nus, les lap-dances, etc. Paul Verhoeven, malicieux, connaissait le potentiel commercial de ces scènes, et prenait bien soin de les évoquer dans toutes les interviews qu’il accordait à la presse internationale, qui faisait ses choux gras de tant de détails croustillants :
« Joe [Eszterhas] et moi avons loué une danseuse pour qu’elle nous fasse une danse privée. Du lap-dancing : la strip-teaseuse s’assoit nue sur un mec et elle frotte ses fesses sur son entrejambe jusqu’à ce qu’il jouisse. J’avoue que ça m’a fait un sacré effet ! (…) Mon intérêt original, c’était Las Vegas. Et les numéros de music-hall. Et le nu. J’adore regarder des filles à poil, j’adore les fesses et les nibards. »26
Cela ne date pas d’aujourd’hui, la seule évocation du mot « sexe » augmente en conséquence le tirage du moindre magazine27. Il est vrai aussi que Verhoeven est loin d’avoir la langue dans sa poche à ce niveau là. Cependant, passée la surenchère de poitrines dressées et de fesses s’agitant en rythme, le film du hollandais dévoile rapidement sa nature de conte de fées pour adultes. Les films de Verhoeven sont souvent basés sur le dévoilement de la violence sous-jacente dans tous les rapports humains : ici, on est plus en face de la confrontation violence humaine / violence sexuelle, on peut définir Showgirls comme un conte de la violence sexuelle. Par ailleurs Las Vegas est l’endroit idéal pour parler de sexualité, car c’est une ville d’apparence et d’argent, et comme Verhoeven nous le rappelle à de nombreuses reprises dans le film par l’utilisation du montage parallèle, « Las Vegas » finit toujours par rimer avec « Tits n’ass » (des nichons et du cul).
Las Vegas c’est donc la capitale de la perversité, le miroir aux alouettes du rêve américain basé sur le pognon (les innombrables casinos et jeux d’argent) et le cul (les shows nus, les paillettes…). Les rapports entre sexe et argent sont en effet proprement captivants dans le film. Par exemple, une danseuse, Hope, se voit accueillir pour son premier show par des recommandations tout bonnement salaces de la part de son patron :
« If you wanna last longer than a week, you give me a blowjob. First I get you used to the money, then I make you swallow. »28
De même, lors d’une séquence particulièrement érotique, on découvre Nomi ayant une relation sexuelle avec Zack dans la piscine de celui-ci. On peut légitimement se demander de quelle nature est le désir de Nomi quand elle couche avec Zack, qui est le directeur artistique du Stardust ; est-ce un acte calculé pour monter en grade ? Ici le sexe serait utilisé par Nomi comme un moyen comme un autre de monter dans la société : le sexe comme moyen d’ascension sociale. La danse et le sexe sont également très liés, on le sent en voyant Elizabeth Berkley se déhancher au Cheetah’ club sur une musique très syncopée, très sensuelle, très sexuelle, comme une relation déchaînée (cf. la séquence de la piscine évoquée à l’instant).
Rappelons que l’essentiel de la presse française a lapidé le film, si l’on excepte les magazines liés de près ou de loin au cinéma « de genre » : on pense forcément à Impact (spécialisé dans le cinéma d’action) ou encore à Hot Vidéo (spécialisé dans le X), dont les journalistes ont toujours défendu le film, même si celui-ci n’appartenait pas forcément au genre qu’ils avaient l’habitude de défendre… Même si dans l’inconscient général, Showgirls se rapproche vaguement du cinéma porno. Pourtant, le scénario de Joe Eszterhas est éloigné du scénario « type » des porno des années 90, dont le récit se déroulait le plus souvent dans des milieux bourgeois, et dont la plupart des scènes de sexe étaient sont superflues au niveau de la narration, dans le sens où elles n’apportaient rien au récit : on passe souvent sans transition du jardin de la demeure bourgeoise (la bonne + le jardinier) au living room (soubrette + maître de maison) puis de la cuisine (cuisinier + cadette) à la chambre à coucher (soubrette + maîtresse de maison) en passant –bien sûr– par le garage (chauffeur + aînée)29. Rien n’est vraiment motivé par l’histoire du film. Dans le cas de Showgirls, les scènes de sexe étaient motivées par le scénario du film, certes brut de décoffrage et dépouillé, tandis que les preux chevaliers des bonnes mœurs dans la presse française vilipendaient Showgirls en balançant grosso merdo que le scénario d’Eszterhas était destinée à un public de bourrins abrutis, comme le démontre bien cet extrait de la critique publiée en 1996 dans Les cahiers du cinéma :
« Cette liberté artistique nouvellement conquise sert à l’auteur et au réalisateur à faire passer quelques idées assez rances sur le sexe et le pouvoir (…) Ce qu’il y a de plus frappant dans ce film ne procède pas de sa franchise sexuelle, qu’on peut retrouver dans d’innombrables films à petit budget diffusés aux États-Unis par le câble ou par vidéocassettes, mais par la pédanterie de la mise en scène, qui utilise la vénérable grammaire du cinéma classique pour s’assurer que le spectateur le plus bouché comprendra (…) L’unique manifestation de courage esthétique de la part de Verhoeven : Elizabeth Berkley et Gina Gershon, les actrices qui jouent respectivement Nomi et Cristal, sont réellement vulgaires. »30
Mais comparer Showgirls aux pornos du samedi soir sur le câble, ou même aux films érotiques soft produits par les grands studios US durant les années 80/90 dénote en réalité d’une méconnaissance absolue du genre, le film de Paul Verhoeven n’envisageant pas l’érotisme sous l’angle le plus commercial qui soit31, exit la bourgeoise entre deux âges découvrant enfin sa sexualité en exécutant un strip-tease derrière des stores vénitiens, il s’agit ici d’une jeune femme sans le sou, dynamique et sans aucun complexe : on s’approche plus de l’image de la lolita, de la nymphette faussement innocente, dans l’air du temps comme le prouvera dans les années qui suivraient l’explosion de chanteuses telles que Britney Spears ou Alizée, et que Verhoeven a choisi pour des raisons très précises, que nous expose l’actrice/réalisatrice Ovidie :
« La production européenne de films pornographiques a décidé à partir de la deuxième partie des années 90 de ranger au placard la Femme au profit de la Lolita. Phénomène qui se retrouve dans les autres domaines du show-business (chanson, cinéma…). Car la Femme, en tant qu’être puissamment sexuel, fait peur. La Lolita rassure l’Homme. Sa jeunesse et sa pureté factice lui donnent un statut d’infériorité. L’actrice (…) telle que beaucoup d’hommes la fantasment (fraîchement majeure, blonde, yeux bleus, peau fine) les apaise de leur terreur face à la figure de Lilith. »32
Peut-être cet aspect a-t-il dérangé la critique internationale. Sur le fond, Showgirls prend donc le contre-pied du schéma narratif habituel du genre érotique, et met en évidence de façon factuelle, en les faisant apparaitre de façon claire et nette, des thèmes généralement sous-jacents dans ce cinéma, comme la relation entre le pouvoir économique et le pouvoir sexuel. En ce qui concerne la forme, il s’écarte volontairement du cinéma érotique commercial et de la pornographie de l’age d’or en refusant l’image de la Femme et en privilégiant l’image de la lolita, femme-enfant (aux formes plus androgynes, nous y reviendrons) rassurante face à l’image de Lilith, première femme d’Adam, qui représente la puissance de la féminité et la liberté sexuelle, Lilith ayant, rappelons-le, quitté l’Eden car elle refusait la soumission à son compagnon.
« Les films pornographiques sont vraiment chiants, je ne peux pas les regarder plus de quelques minutes. D’un autre côté, je crois que des éléments sexuels peuvent être intégrés de façon intéressante, que ce soit dans la photographie, la mise en scène ou tout autre art visuel, peinture et sculpture en particulier. (…) La pornographie n’a qu’un but : préparer à l’action sexuelle, quelle qu’elle soit ! Il n’y a aucune transcendance là dedans, c’est juste un pénis qui entre dans un vagin et va et vient, avec des testicules qui se baladent, rien de plus ! Par contre, lorsque l’on utilise de manière à dépasser ce cadre restreint, alors il outrepasse les réalités biologiques et les remplace par quelque chose qui a d’avantage de sens qu’une simple activité sexuelle. »33
Au niveau des éclairages, Verhoeven et son chef-opérateur Jost Vacano ont manifestement choisi d’aller à l’inverse de la démarche généralement utilisée aux États-Unis. En effet, on sent dans Showgirls une prédominance des textures sur les formes, quand le cinéma américain privilégie habituellement plutôt la forme aux textures. Ici, Verhoeven et Vacano portent visiblement une attention toute particulière aux textures dans l’image, c’est à dire que le grain de la peau des actrices et des acteurs est montré avec un soin maniaque : le spectateur pourra voir apparaître la couleur, le grain de peau des acteurs, même jusqu’à leur pilosité (bras, jambes, etc.). Et même si Verhoeven utilisera peu de gros plans dans son film, il était important d’utiliser ce style de photographie. Ne serait-ce qu’au point de vue narratif, il fallait appuyer sur la sueur des danseuses, leur fatigue physique, pour mieux pouvoir ensuite s’attarder sur leur fatigue morale. Et s’il est un aspect formel sur lequel Verhoeven se place en contradiction radicale avec le cinéma érotique ou pornographique contemporain, c’est bien sur cette question de la photographie. Car si effectivement Verhoeven utilise le même type d’éclairage et de lumière que dans ce type de cinéma, les fins sont différentes.
« Il est rare qu’une scène hard ne soit pas menée « jusqu’au bout ». Elle doit toujours se terminer par l’éjaculation triomphante de l’homme. (…) Le rapport sexuel s’arrête lorsque l’homme jouit. Si la femme a eu suffisamment de plaisir avant, tant mieux. Sinon, tant pis pour elle. (…) La présence de sperme n’est certainement pas condamnable en tant que telle d’un point de vue féministe. Il est cependant regrettable qu’elle soit la seule sécrétion autorisée. Toutes celles concernant les femmes sont bannies : pertes, menstrues, éjaculations féminines, etc. Tout liquide sortant du sexe de la femme est considéré comme sale. »34
Ainsi, sur cet aspect précis, on l’a déjà vu, Verhoeven n’adopte pas la ‘langue de bois’ dominante des producteurs et réalisateurs de cinéma quel qu’il soit X : le spectateur assiste effectivement à un surprenant coïtus interruptus, entre Nomi et James, sous prétexte que celle-ci a ses règles, ce que l’homme s’empressera de vérifier à l’image. Cependant, en ce qui concerne l’achèvement des rapports sexuels, la question peut légitimement davantage se poser. Dans la séquence de la ‘danse privée’, Nomi effectue un jeu de séduction et de domination manifeste : c’est elle qui décide de l’éjaculation de Zack, et si les rapports de séduction/domination (imposés par le côté déjà très phallocrate de la ‘danse privée’ dans son concept : l’homme paie pour prendre seul du plaisir) s’arrêtent entre Zack et Nomi après que celui-ci ait éjaculé, ces rapports de force continuent entre Nomi et Crystal, car celle-ci détient entre ses mains l’autre pouvoir phallique : le pouvoir financier. Showgirls est donc très surprenant au niveau narratif autant que formellement, Verhoeven tentant de souligner les traits de force (de faiblesse ?) du cinéma érotique classique ou ‘mainstream’ sans forcément en révolutionner foncièrement tous les codes et les règles :
« La scène lesbienne est devenue quasiment incontournables dans les films ‘gros budgets’. Elle doit mettre en scène des femmes hétérosexuelles et exciter les hommes sans pour autant les effrayer. Ce type de scènes n’offusque plus personne, et cela est fort positif. Mais il est dommage que la mise en scène d’une sexualité entre deux hommes demeure choquante. La pornographie ‘mainstream’ ne s’est toujours pas attaquée à ce tabou qu’elle continue de considérer comme une atteinte à la virilité. »35
Si l’on n’est pas obligé d’adhérer au film, reconnaissons-lui au moins cela : Showgirls est le premier ‘blockbuster’ érotique de l’histoire, reprenant les codes du cinéma de charme tout en étant destiné à un large public, même s’il ne s’agit peut-être pas du public habituel des blockbusters : ce n’est pas un film familial, on ne se déplace pas pour voir Showgirls le dimanche en famille. D’ailleurs, sans vouloir jouer les prudes, c’est tout de même un peu fort que le film de Verhoeven n’ait été interdit en France qu’aux moins de douze ans. D’abord, on le rappelle à nouveau, le film était aux U.S.A. interdit aux moins de 17 ans ; il a été conçu comme un film adulte destiné à un public adulte. Ensuite, selon la législation française, les films érotiques sont généralement interdits en dessous de seize ou dix-huit ans. Cette absence d’interdiction est d’autant plus troublante que le film de Verhoeven est à la fois assez érotique, car il propose une ou deux scènes particulièrement crues, et profondément dérangeant, car il provoque à de nombreuses reprises un sentiment de malaise chez le spectateur, qui est souvent placé par la mise en scène en position de voyeur impuissant, à la façon des spectateurs des shows privés de Nomi dans le film, qui ne peuvent que regarder la danseuse sans agir, sous peine de se faire vertement jeter dehors.
La position de voyeur est certes inéluctable au cinéma, mais elle est ici synonyme de malaise parce que la mise en scène rappelle constamment au spectateur l’inconfort de cette position : difficile par exemple, pour qui aura vu le film en salle, de ne pas détourner les yeux de l’écran durant la très éprouvante séquence du viol de Molly…
« Personnellement, j’essaie de séduire mon audience, de la sécuriser, de lui inspirer un sentiment de confort. Une fois tranquillisée, je peux la frapper d’autant plus fort ! »36
Définitivement, Showgirls n’est pas un film familial, et c’est peut-être ce qui lui valut son cuisant échec au box office mondial : on ne reprend pas les codes du cinéma érotique sans risquer d’être cantonnés par tous au simple rayon « porno », et les amateurs du film d’être considérés comme des beaufs ou pervers en puissance. Showgirls ou le plaisir coupable absolu, le film à visionner seul, celui dont on devrait cacher l’existence sous son manteau… Heureusement, bien avant que Jacques Rivette ne donne l’absolution aux fans du film, Showgirls était par lui-même parvenu à convaincre les moins obtus en vivant une seconde vie grâce au marché de la vidéo, sur lequel il demeure une valeur sûre, tous supports confondus (VHS, Laserdisc, DVD, déjà deux Blu-ray édités en France à quatre ans d’intervalle…).

Le Blu-ray
[5/5]
Showgirls intègre donc aujourd’hui la prestigieuse collection de digipacks cartonnés des « versions restaurées par Pathé », que le cinéphile pourra ranger aux côtés des Enfants du Paradis de Marcel Carné ou de Paradis perdu d’Abel Gance. Au coffret « VIP Edition » américain, qui affichait des goodies d’une vulgarité décomplexée (très représentatifs du film par ailleurs !) tels que les cache-tétons à pompons ou les shots de tequila aux couleurs du film, Pathé privilégie donc le sérieux et la classe.
A l’occasion de cette nouvelle édition Blu-Ray (qui fait suite à une première sortie du film en Blu-ray en 2012 dans une collection de galettes à packaging et à prix réduits), le film de Verhoeven a été restauré en 4K par Pathé sous la supervision du réalisateur. Et le résultat est de toute beauté : le grain argentique n’a pas été gommé, le piqué est d’une précision surprenante, les couleurs sont extraordinaires (saturées à mort tout en préservant des noirs denses et profonds) et le tout affiche un niveau de détails très élevé ; ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de captures d’écran comparant les éditions de 2012 et de 2016 – ces dernières ont pour des raisons techniques du être redimensionnées en 1280×720.
Côté son, VF et VO sont proposées dans des mixages DTS-HD Master Audio 5.1 dynamiques et enveloppants : la spatialisation est très immersive, la scène arrière tire son épingle du jeu et les basses sont très impressionnantes, surtout durant les séquences musicales.
Du côté des suppléments, si Pathé a décidé de ne pas rapatrier les bonus de l’édition Blu-ray US, l’éditeur nous propose en revanche un entretien inédit avec Paul Verhoeven (en HD s’il vous plait), ainsi que les images de la remise du Razzie Awards du pire réalisateur de l’année, dont on parlait un peu plus haut. Voici donc une édition qui n’a pas volé son appellation de « définitive ».
1 Jean-Marc Bouineau, Le petit livre de Paul Verhoeven, un livre pirate, Spartorange, Garches, 1994, p.72.
2 Alain Kruger, Eric Libiot, « Entretien avec Paul Verhoeven », Premiere, Août 1995, page 74.
3 Jean-Marc Bouineau, Paul Verhoeven beyond flesh and blood, Le cinéphage, Aubervilliers, 2001.
4 Los Angeles Times, novembre 1995, cité par Rob Van Scheers, Paul Verhoeven. Traduit (en anglais) par Arletta Stevens. Faber and Faber, Londres, 1997, p. 276.
5 Newsweek, novembre 1995, cité par Rob Van Scheers, Paul Verhoeven, p. 275.
6 New York Times, novembre 1995, cité par Rob Van Scheers, Paul Verhoeven, p. 276.
7 The Hollywood Reporter, novembre 1995, cité par Rob Van Scheers, Paul Verhoeven, p. 275.
8 Diastème, Premiere, février 1996, p.16.
9 Rob Van Scheers, Paul Verhoeven, p. 8.
10 Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, 1978.
11 Premiere, août 1995.
12 Variety, novembre 1995, cité par Rob Van Scheers, p. 278.
13 Premiere, août 1995.
14 Aux États-Unis, beaucoup de starlettes viennent de l’industrie du porno, surtout dans ce genre de rôles qui nécessite souvent plus de qualités physiques que de réelles qualités d’actrice : on ne leur demande bien souvent que de se déshabiller. Elles ne font généralement qu’un ou deux films avant de retourner à l’anonymat ou au porno : on pense par exemple à Marilyn Chambers qui a tourné dans Shivers (Frissons) de David Cronenberg, à Traci Lords, ou en France Brigitte Lahaie ou, plus récemment, Tabatha Cash.
15 Adam Smith, « Interview with Paul Verhoeven », Empire n°137, novembre 2000, p.116.
16 D’après Roland Barthes, ce terme désigne les personnes amoureuses du texte du marquis de Sade : les Sadiens sont ceux qui voyaient un grand écrivain en la personne du divin marquis.
17 Premiere, août 1995.
18 « Je ne suis pas une pute »
19 « Tu es comme moi, chérie, tu es une pute… »
20 « la vie, ça craint…»
21 On pense notamment à la distanciation par l’ellipse chez Erich Von Stroheim (Les rapaces), la musique chez Stanley Kubrick (Orange mécanique), la distance de caméra chez Brian De Palma (Outrages) ou Lars Von Trier (Dogville), ou encore le plan-séquence abominable mais tape à l’œil chez Gaspar Noé (Irréversible)
22 « pute à quinze dollars »
23 Premiere, août 1995.
24 p. 86.
25 François Cognard, « Les images pour le dire », Starfix n°62, Juillet 1988, p. 44.
26 Jeffrey LANTOS, « Entretien avec Paul Verhoeven », Entrevue n°43, Février 1996, p. 40.
27 Début 1996, lors de la sortie de Showgirls en salles, XL le magazine titrait « Plus sexe que Basic Instinct », Entrevue titrait « Le public veut du cul et de la violence », etc.
28 « Si tu veux durer plus d’une semaine, tu me tailles une pipe. D’abord tu t’habitues à l’argent, puis je te ferai avaler. »
29 Un amusant tableau-type avait été établi en 1978 par Alain Marty dans La revue du cinéma Image et son n°329, p. 85.
30 Bill Krohn, « Showgirls », Les Cahiers du Cinéma n°498, janvier 1996, p.81.
31 à savoir celui de « l’âge d’or » du cinéma érotique, c’est à dire l’époque où il était projeté en salles : les années 70, période durant laquelle Verhoeven surfait sur la vague du cinéma pour adultes avec Turkish delight.
32 Ovidie, Porno Manifesto, Flammarion, Paris, 2002, p. 86.
33 Jean-Marc Bouineau, Le petit livre de Paul Verhoeven, un livre pirate, p.70.
34 Ovidie, Porno Manifesto, p. 89.
35 Ovidie, Porno Manifesto, p.89-90.
36 Jean-Marc Bouineau, Le petit livre de Paul Verhoeven, un livre pirate, p.36.






































