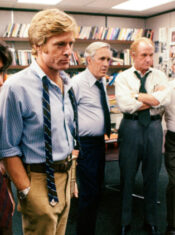La Condition

France, 2025
Titre original : –
Réalisateur : Jérôme Bonnell
Scénario : Jérôme Bonnell, d’après un roman de Léonor De Récondo
Acteurs : Swann Arlaud, Galatéa Bellugi, Louise Chevillotte et Emmanuelle Devos
Distributeur : Diaphana Distribution
Genre : Drame
Durée : 1h43
Date de sortie : 10 décembre 2025
3/5
Grâce à la prise de conscience générale déclenchée par le mouvement #MeToo et aux innombrables luttes féministes qui l’ont précédé, osons espérer que la place des femmes change dans la société. Ce qui change en même temps, c’est la représentation véhiculée par les personnages féminins d’une époque, où leur place était invariablement à la cuisine ou aux côtés de leur mari, de préférence dociles et effacés. Rarement cette démarche tout à fait nécessaire de réappropriation d’un rôle a été entreprise avec un mélange aussi exquis de fermeté et de douceur que dans La Condition.
Découvert au Festival d’Albi, le huitième long-métrage de Jérôme Bonnell porte avec une subtilité confondante le message universel de la libération du joug du patriarcat. Plutôt que de forcer le trait, ni du côté des femmes émancipées, ni de celui de l’homme borné dans sa supériorité supposée, la rébellion au féminin s’y articule avec une élégance filmique qui ne perd pourtant jamais de vue la monstruosité sous-jacente de cette forme de société dans laquelle l’homme a cru bon de s’accorder tacitement tous les droits.
Alors que la facture formelle du film est déjà de premier ordre, avec une mention spéciale pour la belle bande originale signée David Sztanke, le cri de malaise mis en sourdine tout au long du récit gagne ses lettres de noblesse à travers des interprétations elles aussi parfaitement conscientes des enjeux majeurs de l’intrigue. Ceci vaut à la fois pour Swann Arlaud en notable sexuellement frustré qui ne pense qu’à son propre plaisir et au maintien des apparences et pour un trio d’actrices sachant entièrement rendre justice aux nuances presque imperceptibles de leurs rôles respectifs.
Tandis que l’apparition d’Emmanuelle Devos en mère alitée et insupportable s’avère volontairement tronquée par le handicap de cette femme mise hors jeu à cause de la maladie et que Galatéa Bellugi incarne admirablement la honte de cette bonne réduite à sa fonction soi-disant première, c’est surtout Louise Chevillotte qui nous a subjugués en épouse négociant sans cesse les espaces précaires de sa liberté.

Synopsis : En 1908, le notaire André règne avec une main ferme sur sa maison. Il y fait taire les manifestations bruyantes de sa mère, muette après des attaques récentes. Face au refus d’intimité de la part de sa femme Victoire, il se console auprès de la jeune servante Céleste. Mais à force de rapports sexuels non-consentis, cette dernière finit par tomber enceinte. Pas longtemps dupe de cette situation compromettante, autant pour elle-même que pour son mari, Victoire est prête à résoudre ce problème. A une condition …

Elle l’aura bien cherché
En dessous d’un cadre de confort manifeste, propre à la classe sociale des notables de province au début du siècle dernier, il y a quelque chose de profondément pourri. Dans la pénombre abondante, tout juste éclairée par quelques bougies, des choses pas très nettes se trament dans la demeure bourgeoise d’André. Or, la mise en scène souvent sublime de Jérôme Bonnell trouve le ton juste pour ne faire de cette prémisse étouffante ni le conte glauque d’un homme capable de tous les sévices et de toutes les abominations parce que son statut social l’y autorise, ni un hymne utopique sur la révolte des femmes qui arriveraient comme par miracle révisionniste à s’en affranchir.
Non, la très grande, voire l’immense qualité de La Condition est de contourner le fatalisme manichéen, habituellement de mise pour évoquer ce genre de sort au féminin empêché, afin de sonder simultanément le mal-être des hommes et des femmes qui peinent à tirer leur épingle de ce jeu archaïque.
En effet, la délicatesse du jeu de Swann Arlaud permet à son personnage de garder une certaine fragilité ou tout au moins une ambiguïté dans ce traquenard conjugal, survenu essentiellement par sa propre faute. Certes, le questionnement sur ses origines appartient aux détails un peu moins convaincants de l’intrigue, tout comme le refuge trompeur et convenu dans l’alcoolisme et le tabagisme. Mais notre identification avec les deux personnages féminins malmenés passe aussi et avant tout par cette virilité en crise. Elle ne sait pas mettre des mots sur le dysfonctionnement d’une structure sociale, qui était d’ores et déjà bancale du temps de ses parents.
Et pourtant, l’aveuglement induit par les droits et les conventions que cet homme avare en scrupules croit acquis ne le rend pas automatiquement antipathique. Car au fond, il est juste le fruit de son temps, comme le nôtre constamment en pleine évolution des rapports de force – et hélas très rarement de vraie harmonie – entre les hommes et les femmes.

Voir la fragilité de l’autre
Cependant, la lutte rétrograde du mari, passablement tyrannique, pour asseoir sa position dominante n’est au fond que l’arrière-plan tortueux d’une histoire infiniment plus douce qui se passe en réalité entre les deux femmes, Victoire et Céleste. La première est l’exemple parfait d’un individu en avance sur son temps, qui se heurte néanmoins aux limites rigides que la société lui impose. Elle sait qu’elle ne correspond pas à l’image qu’on se fait d’une bonne épouse, mais elle cherche quand même à s’y conformer tant soit peu. Contrairement à l’amie d’une connaissance de son mari, qui, elle, laisse libre cours à ses états d’âme, quitte à passer pour une frivole ridicule. Un rôle taillé sur mesure pour Camille Rutherford, en somme. Alors que Victoire avance presque jusqu’au bout de façon couverte, la duplicité de sa personnalité rendant l’interprétation de Louise Chevillotte d’autant plus magistrale !
Avec ses grands yeux de biche et son visage de chien battu, Céleste aurait aisément pu être la proie inoffensive de ce manège dans un foyer conjugal en pleine déroute. Bien que le scénario ne lui alloue qu’une place assez passive, c’est peut-être elle le grain de sable salutaire, susceptible d’ouvrir des hypothèses jusque là impossibles à imaginer. Sans sa capacité de susciter une chose sinon cruellement absente de l’univers de La Condition, l’empathie, le récit aurait pu se fourvoyer dans des directions sensiblement plus funestes. Ces dernières ne manquent évidemment pas, chaque fois que le statu quo de la respectabilité de façade est mis en branle. Mais l’équilibre finement ajusté entre ces trois personnages centraux que tout devrait opposer fait qu’on parvient malgré tout à une conclusion timidement optimiste.

Conclusion
Première séance de notre séjour au Festival d’Albi et déjà un petit premier coup de cœur ! En déjouant avec une finesse redoutable tous les pièges narratifs qu’un sujet aussi délicat aurait dû mettre sur sa route, Jérôme Bonnell accomplit une prouesse filmique assez inouïe. C’est-à-dire d’évoquer le destin nullement enviable de femmes d’il y a un siècle sans en faire un manifeste tendancieux, ni un spectacle déprimant sur la laideur du sexisme de la part d’hommes placés alors fermement en haut de la pyramide sociale. Avec en prime des interprétations excellentes et des prestations techniques qui ne le sont pas moins, le réalisateur pourrait bien avoir ouvert la voie à un nouveau genre de revendication féministe au cinéma : sans agressivité excessive, mais avec une conscience aiguë des torts énormes du passé qu’il s’agit à présent de nommer et, dans le meilleur des cas, à réparer.