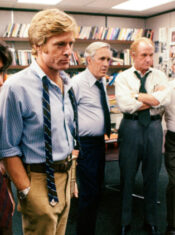Écrire la vie
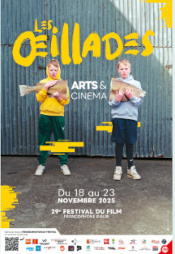
France, 2025
Titre original : –
Réalisatrice : Claire Simon
Scénario : Claire Simon
Distributeur : –
Genre : Documentaire
Durée : 1h31
Date de sortie : –
3,5/5
En parfait ignare de la chose littéraire que nous sommes, hélas, notre seule incursion dans l’univers d’Annie Ernaux a été jusqu’à présent le documentaire que Régis Sauder avait consacré en 2020 à son lien étroit avec la ville nouvelle de Cergy, J’ai aimé vivre là. L’approche de Écrire la vie, présenté en exclusivité au Festival d’Albi avant sa diffusion début décembre sur France 5, est tout autre. C’est davantage son œuvre littéraire d’autobiographie sociale qui y est passé en revue.
Au détail près que Claire Simon, peut-être la plus pointilleuse des réalisatrices de documentaires françaises, n’en fait point un banal support d’hommage à une auteure d’exception. Étudier Ernaux est pour elle un formidable prétexte pour aller à la rencontre des jeunes lycéens aux quatre coins de la France métropolitaine et même en Guyane. Filmés dans leur cadre scolaire, ils tentent de se réapproprier la vision aussi crue que libératrice qu’Ernaux leur a transmise à travers ses romans phares.
A partir d’un dispositif cinématographique aussi simple qu’efficace – quelques plans pour donner un aperçu de l’établissement, l’analyse des textes en cours, suivie de discussions plus libres entre filles et garçons en marge de l’école –, Claire Simon participe à une tâche de vulgarisation des plus précieuses. Cette magistrale opération de libération de la parole digère le texte sans doute comme Annie Ernaux aimerait qu’il le soit : avec des mots et des ressentis d’aujourd’hui, qui trouvent pourtant un écho étonnant dans le quotidien faussement banal de l’autrice au milieu du siècle dernier. Le tout non pas dans un objectif d’hagiographie officieuse, censée rendre ses textes indispensables aux yeux des élèves. Mais en aménageant une place considérable à l’interrogation, ainsi qu’à la lutte si précieuse et vitale entre l’artiste et son public.
Vus de cette façon, les récits de l’autrice octogénaire reprennent vie avec fracas, en tant que fils conducteurs nullement fermés sur eux-mêmes. Au contraire, ils permettent aux adolescents de s’inventer leurs propres récits, en s’inspirant d’Annie Ernaux, soit, quoique sans copier bêtement son parcours personnel tortueux, ni son style d’écriture factuel.
Synopsis : Une figure majeure du féminisme contemporain, Annie Ernaux, Prix Nobel de littérature en 2022, a toujours mêlé l’intime à l’universel. A travers ses romans comme « La Place », « Passion simple », « L’Événement » et « Les Années », elle s’est racontée à la fois elle-même et les préoccupations propres à des femmes de tout âge et de toute origine sociale. Ce sont ces thèmes de la honte sociale et sexuelle qui interpellent les lycéens d’aujourd’hui. Ils ont beau ne pas vivre à la même époque que l’autrice, ses luttes et ses mots, étudiés en classe à Cayenne, Sarcelles, Villefranche-sur-Saône ou Toulouse, leur donnent à réfléchir sur comment écrire leur propre vie.

Une platitude percutante
Le fait d’étudier la littérature ou, pire encore, la poésie à l’école ne nous a jamais particulièrement passionnés. Comment le rapport intime que l’auteur entretient avec le lecteur peut-il raisonnablement entrer dans le cadre préétabli de l’exercice scolaire ? Dans Écrire la vie, l’approche pédagogique est heureusement plus ludique, moins renfermé sur une seule et unique vérité à atteindre à tout prix en guise de résultat à noter. Ici, la lecture commune de quelques œuvres phares d’Annie Ernaux conduit à libérer la parole des jeunes. Attention, pas non plus de manière fulgurante, abolissant par la même occasion toute crainte de trop se dévoiler dans un contexte social pour le moins complexe. Non, Claire Simon sait préserver une distance hautement respectueuse envers ses sujets. Elle ne les provoque pas, mais ne leur tire pas non plus artificiellement les vers du nez, jusqu’à ce qu’ils disent quelque chose d’intellectuellement profond.
La parole ainsi libérée circule sans entraves, soit en reprenant mot pour mot les textes de l’autrice, histoire d’essayer d’apprivoiser tant soit peu leur sauvagerie sociale, soit en les reformulant avec le vocabulaire et les tics linguistiques du milieu des années 2020. L’une ne vaut pas mieux que l’autre dans le cadre d’un documentaire foncièrement à l’écoute de ses intervenants. Quelque part entre des approches similaires de lycée en lycée et des cas particuliers s’installe dès lors un échange magnifique entre le mot écrit et la parole dite, entre l’esprit de critique de la société patriarcale parfaitement formé de l’auteure célèbre et des identités adolescentes qui se cherchent encore. Sans une quelconque finalité dramatique en arrière-pensée, Claire Simon appartenant à ces créateurs si précieux de documentaires qui font entièrement confiance à leurs sujets.
Vu et approuvé
Par conséquent, il y a de la redite et des écarts apparents dans le flux très vaguement narratif d’Écrire la vie. Le tout, afin d’entretenir sans cesse le choc constructif entre la littérature formulée au cordeau des romans sur l’avortement ou sur de pénibles histoires de famille d’un côté et, de l’autre, le caractère improvisé de la pensée réflexive en classe, qui ne cherche guère à passer à la postérité, mais qui doit au contraire exprimer le degré d’abstraction dont les élèves sont capables à l’instant T.
Avec pour supplément fort intéressant le retour sur expérience de lecture que les élèves font entre eux au bord de l’océan – le rêve ! –, dans la cour de récrée, dans un parc ou à l’arrêt de bus. Là encore, la grande liberté de la mise en scène, à prendre tel une force bâtie sur plus de trente ans de carrière dans le domaine du documentaire et non pas comme une absence d’idée directive, laisse libre cours à une forme d’expression que l’on ne sent inhibée ou filtrée que par la conscience du dispositif filmique.
Enfin, la qualité principale de ce documentaire qui mériterait tant d’être également exploité en salles est qu’il dresse le portrait collectif d’une jeunesse loin de tout stéréotype. Par la double intervention miraculeuse de Annie Ernaux, côté littérature, et de Claire Simon, côté cinéma, il confirme ce que nous remarquons régulièrement lors de nos activités associatives en milieu scolaire. Qu’il suffit de stimuler les opinions des élèves, ainsi que le souvenir de leurs propres expériences, aussi partielles soient-elles, pour en tirer des avis aussi recevables que ceux de leurs aînés. Bien sûr, en toute probabilité, aucun futur lauréat du Prix Nobel de littérature ne sommeille en chacune et chacun des élèves filmés. Malgré les belles aspirations de la dernière d’entre elles, pour qui le besoin de lire et d’écrire est déjà bien ancré dans sa vision du monde.
Mais c’est justement cette approche dépourvue d’œillères sur ce que la littérature écrite avec les tripes peut provoquer chez chacun d’entre nous ou bien à tel point on peut passer à côté d’elle sans non plus rater sa vie qui résume admirablement la compréhension la plus large et inclusive possible de ce bien collectif si précieux qu’est la littérature en particulier et que sont tous les arts en général !

Conclusion
Non, Écrire la vie ne nous a pas donné envie de consulter sans tarder le catalogue de notre bibliothèque municipale pour voir combien de livres signés Annie Ernaux y sont disponibles. Son apport à notre façon de concevoir le monde – pourtant déjà passablement figée – est infiniment plus large. Il consiste à apprécier désormais davantage les œuvres d’art plus seulement comme des expériences subjectives, à chérir ou au contraire à bannir à notre petit niveau individuel, mais comme des organismes à la fois vivants et passeurs, appelés à nous rattacher collectivement et selon un éventail illimité de formes de réception à la vie. Ce qui est en soi un accomplissement colossal de la part d’un documentaire qui écoute tout le temps, mais dont le propos ne se fait en fin de compte entendre qu’à condition d’accepter une égalité absolue de la parole. D’où qu’elle vienne et peu importe comment elle arrive à définir la vie à échelles variables.